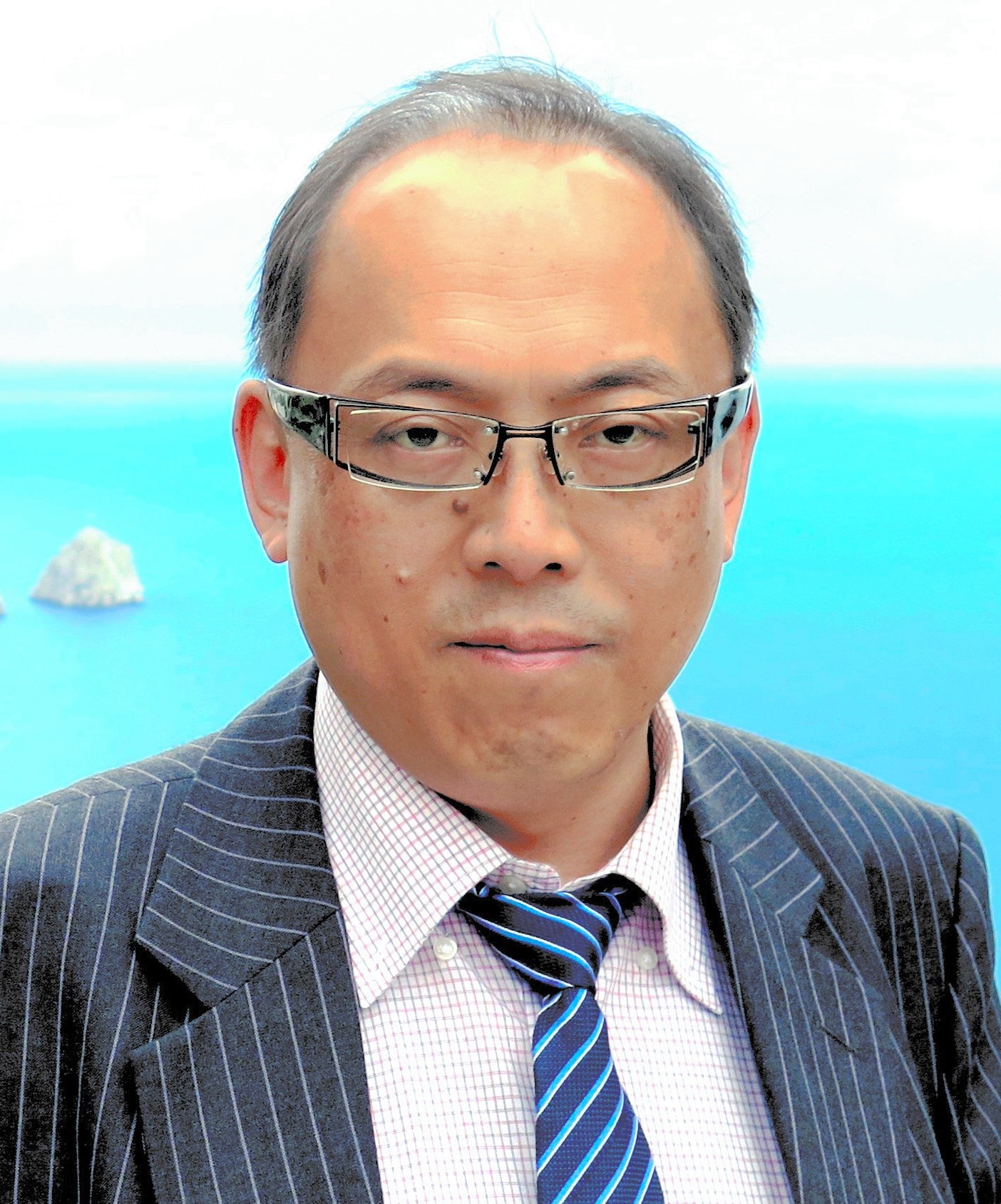コメンタリー
L'équilibre de la terreur a été rompu / Interview avec Marc Hecker

Le Proche et le Moyen-Orient sont en plein bouleversement. Le conflit, qui a débuté par des affrontements entre Israël et le Hamas, s'est étendu à l'Iran et a débouché sur des frappes américaines contre des sites nucléaires. Jusqu'où cette agitation va-t-elle s'étendre — au-delà du Proche et du Moyen-Orient ?
J’ai posé la question à Marc Hecker, directeur exécutif de l’Institut français des relations internationales (Ifri) et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère.
Entretien réalisé à Paris le 1er juillet 2025
(Propos recueillis par Norito Kunisue, Professor de projet à l’Université de Tokyo)

— Récemment, la guerre a éclaté entre Israël et l'Iran, et les États-Unis ont mené des frappes en Iran. Les choses évoluent trop rapidement pour que nous puissions les suivre. Où cette situation va-t-elle mener ?
Il me semble judicieux d’aborder la situation avec un peu de recul. Il faut, a minima, remonter au 7 octobre 2023, un événement qui a changé les dynamiques au Moyen-Orient.
Si l’on compare la situation d’aujourd’hui (juillet 2025) à celle d’avant le 7 octobre, on constate que l'équilibre des puissances (balance of power) a évolué de manière significative. Les relations entre Israël et l'Iran reposaient sur une forme d’équilibre de la terreur qui a été rompu. Israël apparaît aujourd’hui comme un acteur régional dominant, tandis que Téhéran est très affaibli.
Avant le 7 octobre 2023, l’Iran disposait de plusieurs atouts. Le premier, ce sont les proxies, « l’Axe de la résistance ». Le plus puissant de ces groupes était le Hezbollah, mais il y en avait d’autres. On peut citer le Hamas, le Djihad islamique, des milices chiites en Syrie et en Irak, ou encore les Houthis au Yémen. On peut également mentionner, même s’il s’agit d’un acteur étatique, le régime syrien de Bachar el-Assad qui était très proche de Téhéran et avait bénéficié du soutien du Hezbollah pendant la guerre civile syrienne.
Depuis le 7 octobre, les Israéliens ont mené une guerre contre tous les proxies, ce que l’on a appelé la « guerre sur sept fronts ». Dans le discours des stratèges israéliens, il était clair que le cœur de cette nébuleuse, c’était l’Iran, et que le problème ne serait pas véritablement résolu tant que l’Iran continuerait à disposer de ses capacités de nuisance. Outre les proxies, deux points préoccupaient fortement les Israéliens : les missiles balistiques de Téhéran – capables de frapper tout le territoire israélien – et la progression du programme nucléaire iranien. L’enrichissement de l’uranium avait crû de manière significative ces dernières années, comme cela avait été documenté par l’Agence internationale de l’énergie atomique.
Après avoir considérablement affaibli le Hezbollah et après avoir réduit les capacités de défense antiaérienne iranienne en octobre 2024, les dirigeants israéliens ont perçu une « opportunité historique » de retarder voire d’éliminer le programme nucléaire de Téhéran. Ce sentiment a été renforcé par la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine. Peu de temps avant cette élection, j’avais assisté à un échange avec un membre de l’establishment sécuritaire israélien. Pour résumer, la teneur du message était la suivante : « Si Kamala Harris est élue, Israël pourrait mener une opération en Iran rapidement, avant sa prise de pouvoir en janvier 2025, car il y aurait des craintes qu’une nouvelle administration démocrate cesse de fournir certaines armes à Israël. En revanche, si Donald Trump est élu, alors la fenêtre d’opportunité s’élargit et permet de gagner du temps, avec l’idée que les Israéliens pourraient tenter de convaincre le président républicain de se joindre à une opération militaire ». C’est finalement ce qui s’est passé.
L’opération israélienne visant le programme nucléaire iranien n’a donc pas été une véritable surprise. Depuis plusieurs mois, on sentait que la probabilité d’une telle action augmentait. Ce qui était moins attendu, c’était l’élargissement des cibles à d’autres infrastructures et le discours qui a émergé autour du changement de régime.
—
Cela veut dire que l’attaque avait été bien prévue avant la date des élections américaines ?
Je ne dirais pas que c’était prévu, mais cela faisait partie des scénarios envisagés et préparés. Il y a quelques années, j’avais demandé à un officiel israélien du milieu de la défense, s’il existait des plans pour intervenir dans un pays donné du Moyen-Orient. Je ne me souviens plus de quel pays il s’agissait, mais la réponse avait fusé spontanément : « Mais on a des plans pour tous les pays de la région ! ». Il ne faut pas interpréter cette réponse comme une preuve de visées expansionnistes. Il faut la comprendre de deux manières. D’une part, la planification fait partie de la culture militaire. Dans beaucoup de pays, des officiers sont chargés de planifier toutes sortes d’opérations, même si la probabilité d’occurrence est faible. D’autre part, il y a une spécificité israélienne, celle d’avoir le sentiment d’évoluer dans un environnement hostile où il faut sans cesse se préparer au pire.
Il y avait donc certainement des plans pour l’Iran, mais aussi pour la Syrie. Quand le régime de Bachar el-Assad est tombé, l’armée israélienne a pu réagir très rapidement, car les plans d’intervention étaient prêts. Le métier des officiers chargés de la planification est de se préparer à l’imprévu. Les militaires doivent pouvoir présenter rapidement des options aux responsables politiques si un événement improbable se produit. Ensuite, en fonction du contexte et des intérêts bien pesés, ce sont les politiques qui décident d’activer ou non ces plans.
L’intervention israélienne a montré une coordination poussée entre la dimension militaire (en particulier l’armée de l’Air) et la dimension du renseignement assurée par le Mossad. Une coordination de ce type ne s’acquiert pas en quelques semaines, ni même en quelques mois.
—
Les accords d’Abraham, conclus entre Israël et plusieurs États arabes depuis 2020, ont rapidement permis d’approfondir les relations entre les parties. En conséquence, la question palestinienne a été mise de côté. Dès lors, Israël est devenu un acteur diplomatique majeur au Proche et Moyen-Orient. Pourquoi était-il alors nécessaire pour Israël de recourir à des moyens militaires ?
Les accords d’Abraham ont été signés par quatre Etats arabes : les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Mais ces accords ont été accueillis fraîchement voire avec hostilité dans une partie du monde arabe et plus encore du monde musulman. Une des raisons de cette hostilité était, précisément, la mise à l’écart de la question palestinienne.
Cette question est revenue avec force sur le devant de la scène le 7 octobre 2023. Israël a été pris de court. Les gouvernements israéliens successifs considéraient que le cadre général des accords d’Abraham leur convenait parfaitement. Cela permettait de développer des coopérations avec des États sunnites dits modérés et de remplacer le paradigme des accords d’Oslo, considéré comme un échec.
L’un des espoirs des Israéliens était que cet axe sunnite devienne également un axe de résistance à l’influence iranienne. Mais les signataires des accords d’Abraham restaient très prudents sur ce point. Pour eux, le rapprochement avec Israël était une manière de développer des relations, notamment commerciales, et d’instaurer un cadre plus large de paix au Moyen-Orient. Mais il ne s’agissait pas de former une coalition opposée à Téhéran. Sur la question palestinienne, les signataires des accords d’Abraham considéraient qu’en échangeant avec Israël et en développant un cadre de paix, cela permettrait, à terme, d’aider aussi les Palestiniens. En pratique, ce n’est pas ce qui s’est passé, et certains États signataires se retrouvent aujourd’hui en porte-à-faux compte tenu de la tragédie en cours à Gaza qui suscite la colère dans le monde arabe.
On peut considérer qu’Israël a remporté une victoire contre l’Iran et ses proxies, mais l’
opinion publique internationale s’est largement retournée contre l’Etat hébreu en raison de la manière dont a été conduite la guerre à Gaza. La question, désormais, pour les Israéliens, est la suivante : comment mettre fin à cette guerre ?
opinion publique internationale s’est largement retournée contre l’Etat hébreu en raison de la manière dont a été conduite la guerre à Gaza. La question, désormais, pour les Israéliens, est la suivante : comment mettre fin à cette guerre ?
La France et l’Arabie saoudite ont pour projet d’organiser fin juillet une conférence internationale pour mettre en œuvre la « solution à deux Etats ». Mais le gouvernement israélien est totalement opposé à ce type d’initiative. On semble donc aujourd’hui dans une impasse, avec un gouvernement israélien jusqu’au-boutiste, dominé par des partis de droite et d’extrême droite. Certains ministres, au sein de ce gouvernement, ne cachent d’ailleurs pas leurs ambitions, non seulement sur la bande de Gaza, mais aussi sur une grande partie de la Cisjordanie.
La situation actuelle est extrêmement complexe, car l’équilibre des puissances a changé. Israël est dominant et peut jusqu’à présent compter sur le soutien de l’administration Trump qui a nommé à Jérusalem un ambassadeur favorable à la colonisation. Les Palestiniens vivent une tragédie et sont très affaiblis. La communauté internationale apparaît divisée et impuissante.
— Y a-t-il des signes d'amélioration de la situation ?
Non. Les Israéliens pensent pouvoir obtenir des solutions par la voie militaire. L’issue la plus extrême consisterait en des déplacements massifs de populations depuis Gaza. Donald Trump ne l’a d’ailleurs pas exclue lorsqu’il évoquait son projet de transformation de l’enclave palestinienne en « Riviera ». Mais cela semble tout de même inimaginable et irréaliste. La quasi-totalité des États occidentaux — et bien sûr ceux du monde arabe — y sont opposés. Cela constituerait aussi un crime contre l’humanité, tel que défini à l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Mais que pèse aujourd’hui le droit international ? Que valent ces concepts de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, alors que l’administration Trump a placé sous sanction la Cour pénale internationale et que ni la Chine, ni la Russie ne sont parties au Statut de Rome ? A l’heure du retour de la compétition de puissance, le rapport de force brut semble devenu la norme. Mais en même temps, on sait que certains conflits ne peuvent être résolus uniquement par la force. L’action des armées a ses limites.
— Quand on regarde l’attitude de l’Iran après les attaques israéliennes et américaines, il semble que la réponse de Téhéran reste assez limitée…
L’Iran a tiré plusieurs centaines de missiles balistiques sur Israël ainsi que plusieurs centaines de drones. Il y a eu des dégâts importants sur le territoire israélien, mais « seulement » 29 personnes ont été tuées. Compte tenu des destructions de lanceurs et de missiles réalisées par l’armée israélienne sur le territoire iranien, on peut douter du fait que l’Iran dispose encore des moyens de saturer les défenses antiaériennes israéliennes. Ce pays était déjà affaibli avant la « guerre de douze jours » et l’est plus encore aujourd’hui. Le ciel de Téhéran est ouvert et de nouvelles frappes israéliennes ne peuvent être exclues.
Il est difficile d’évaluer précisément l’état du programme nucléaire iranien. Donald Trump prétend que ce programme a été anéanti. Toutefois, la plupart des experts affirment que ce n’est pas le cas. On ignore où se trouvent les quelque 400 kilos d’uranium enrichi à 60 %. Ce qui est sûr, c’est que le programme est retardé, mais on ne sait pas de combien de temps. Pour les Iraniens, l’acquisition de l’arme nucléaire reste probablement un objectif, car les autres piliers de la dissuasion iranienne (les proxies et les missiles balistiques) ont échoué. Et les Israéliens ne laisseront vraisemblablement pas faire. Ils pourraient être tentés de considérer l’Iran comme ils considèrent le Liban : un théâtre où il est possible de frapper ponctuellement lorsqu’une menace importante apparaît.
Beaucoup d’observateurs insistent sur les ennuis judiciaires de Benjamin Netanyahou et sur le fait que la poursuite de la guerre lui permet de se maintenir au pouvoir. Je pense que cette explication est insuffisante. Le Premier ministre israélien se considère investi d’une mission historique de protection du peuple juif. Il prend les appels à la destruction d’Israël émis par l’Iran et l’Axe de la résistance très au sérieux. Il n’hésite pas à comparer le régime des mollahs à l’Allemagne nazie. Et face à menace présentée comme existentielle, aucun compromis n’est possible.
— Quelle est l'attitude des pays européens face à ces changements ?
Ce qui frappe en Europe depuis le 7 octobre 2023, c’est, d’une part, l’incapacité à parler d’une seule voix et d’autre part l’impuissance. Les divergences sont fortes entre les Etats-membres de l’Union européenne et au sein même de ces États, avec des lignes de fracture politique claires. De manière schématique, plus vous allez vers la gauche, plus vous trouvez du soutien à la Palestine ; plus vous allez vers la droite et l’extrême droite, plus le soutien va à Israël. C’est aussi vrai en France, alors même que le général de Gaulle avait été un artisan du rapprochement avec le monde arabe.
Pour ce qui est de l’Iran, l’accord de Vienne sur le nucléaire en 2015 (JCPOA) a été signé par huit parties dont la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Union européenne. L’objectif de ces parties étaient d’éviter que l’Iran ne parvînt à acquérir l’arme nucléaire. Au cours des dernières années, Paris, Londres et Berlin ont publié plusieurs communiqués communs dénonçant les avancées du programme iranien, notamment à l’aune de l’enrichissement de l’uranium. De ce point de vue, les frappes israéliennes pourraient aller dans le sens des objectifs européens, sauf que les moyens employés ne sont pas ceux souhaités par l’Europe. Les moyens privilégiés par l’Europe sont diplomatiques et passent par des institutions internationales chargées du contrôle des engagements pris. Ainsi, on a pu observer un certain embarras des Européens au moment des frappes sur l’Iran. Le nouveau gouvernement allemand a apporté son soutien à Israël. Paris et Londres ont appelé à la retenue et à la diplomatie, sans émettre de condamnation.
—
En Europe, les divergences de vues sur la question palestinienne sont notables. Cependant, si l’on tourne le regard vers l’extérieur du Proche et Moyen-Orient, il semble qu’il existe un certain degré d’unité sur la question ukrainienne…
S’agissant de la question ukrainienne, il faut replacer les choses dans un contexte plus large, et peut-être revenir au discours de JD Vance, le vice-président américain, à la conférence de Munich en février 2025. C’est un discours qui a tétanisé beaucoup d’Européens. Jusqu’alors, le plaidoyer d’Emmanuel Macron pour « l’autonomie stratégique européenne » avait été accueilli fraichement dans plusieurs capitales européennes. Pour certains Etats-membres, il était inconcevable que l’Europe ait, dans un avenir proche, à se défendre seule, sans l’appui des Etats-Unis. La véhémence de JD Vance a fait craindre le pire, d’autant qu’il a été suivi de l’entretien houleux avec Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche et de la suspension de la fourniture de renseignement à l’Ukraine.
La position du président français a parfois été caricaturée. Ce qu’il disait, c’est qu’il fallait que l’Europe développe ses propres capacités, qu’elle soit en mesure d’agir de manière autonome sans dépendre d’un acteur extérieur. Cela ne signifiait pas rompre avec cet acteur, mais se préparer à tous les scénarios possibles, y compris celui d’une diminution significative de la contribution américaine à la défense de l’Europe.
Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump souffle le chaud – et surtout le froid – au sujet de l’Ukraine. La question est de savoir dans quelle mesure et à quelle vitesse les Américains vont se désengager. Globalement, si l’on additionne l’aide civile et militaire apportée par tous les États membres de l’UE et les institutions européennes, l’Europe donne un peu plus que les États-Unis à Kyiv. Mais si les États-Unis arrêtent complètement leur soutien, il faudra trouver environ 40 à 50 milliards d’euros par an, voire davantage — ce qui est loin d’être négligeable dans l’état actuel des finances publiques européennes. De plus, sur certains plans, notamment en matière de renseignement, l’Europe ne serait pas en mesure de compenser un retrait complet des Etats-Unis. La question est donc de savoir ce que fera réellement l’administration Trump, au-delà des déclarations fracassantes. Ce qui se disait en marge du sommet de l’OTAN à La Haye, au Forum public auquel j’ai assisté, c’est que certains experts estiment que les États-Unis n’ont pas intérêt à couper totalement la fourniture de renseignement. Mais tout le monde reste dans l’incertitude, car Donald Trump est impulsif et les positions de son administration peuvent varier d’un jour à l’autre.
— L'avenir semble très difficile.
Dans ce contexte compliqué, les Européens sont relativement fébriles. Cependant, ils ont compris qu’ils devaient réagir. Des expressions comme « réveil stratégique de l’Europe » ou « sursaut stratégique » sont régulièrement employées. En pratique, cela passe par le renforcement du « pilier européen » de l’OTAN. A La Haye, les alliés se sont engagés à augmenter leurs dépenses de défense à 5% du PIB dont 3,5% pour les dépenses militaires stricto sensu d’ici à 2035. C’est un saut considérable pour la plupart des alliés qui requerra des arbitrages budgétaires difficiles.
La déclaration finale du sommet de l’OTAN affirme que la sécurité de l’Ukraine contribue à la sécurité de l’Alliance. C’est pourquoi, les aides à l’Ukraine seront intégrées dans le calcul des 5%.
Il y avait quelques représentants ukrainiens à La Haye. On les sentait fatigués, éprouvés, mais ils conservent de grandes attentes vis-à-vis du soutien extérieur — en particulier européen — car ils savent être à la merci de décisions abruptes de l’administration Trump.
— Il est probable qu’il existe des différences d’attitude dans certains pays, comme l’Espagne, qui hésite.
L’Espagne a négocié une exemption. En effet, le gouvernement espagnol risquait de tomber si Pedro Sanchez acceptait l’objectif de 5% : la présidente du mouvement d’extrême-gauche Sumar avait menacé de quitter la coalition gouvernementale.
Dans d’autres pays, l’objectif risque d’être difficile à atteindre, notamment pour ceux qui sont déjà très endettés. En France, le président Macron souhaite accroître l’effort de défense compte tenu des menaces qui pèsent sur l’Europe, mais dans le même temps, le gouvernement est sommé de faire des économies pour tenter de redresser les comptes publics.
Plus on se rapproche géographiquement de la Russie, plus les États européens investissent dans leur outil de défense. Certains Etats sont déjà proches de l’objectif de 5%. De plus, les populations des pays de l’Est de l’Europe sont convaincues de la nécessité d’investir dans la défense pour se protéger. La population espagnole se sent clairement moins concernée par la menace russe que les habitants des pays baltes.
— Entre la guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien, l’Europe peut-elle encore se permettre d’être impliquée dans les questions indopacifiques ?
Si vous lisez la déclaration finale du sommet de l’OTAN, deux menaces principales sont mises en avant : la Russie et le terrorisme. Lorsqu’on parle de terrorisme, on pense aux pays où ont prospéré Al-Qaïda et Daech, comme l’Afghanistan et la Syrie. Mais on pense aussi à l’Afrique qui apparaît comme le nouveau centre de gravité de la mouvance djihadiste internationale. Il n’y a donc pas que le Proche-Orient et l’Ukraine, mais aussi le flanc sud.
Quid de l’Indopacifique ? La France – qui vient de publier une actualisation de sa stratégie pour l’Indopacifique — est l’un des pays européens les plus actifs dans cette zone. Elle y possède des territoires, que ce soit dans l’océan Indien (comme l’île de la Réunion) ou dans l’océan Pacifique (comme la Polynésie française). En tout, 1,6 million de Français vivent dans l’Indopacifique. Pour la France, il y a donc un enjeu de souveraineté dans cette région du monde. Il y a aussi des enjeux économiques. Plus de 90% des Zones économiques exclusives (ZEE) françaises se trouvent dans l’Indopacifique.
Fin mai 2025, le président Macron a été invité à prononcer le discours d’ouverture du Shangri-La Dialogue à Singapour. Il y a notamment rappelé que les théâtres européen et asiatique sont désormais interconnectés, citant l’implication de troupes nord-coréennes dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. A ce sujet, il a prononcé une phrase qui a fait l’objet de nombreux commentaires : « Si la Chine ne veut pas que l’OTAN s’implique en Asie du Sud-Est ou en Asie, elle devrait empêcher la République démocratique populaire de Corée de s’engager en Europe ». Une autre partie de son discours qui a suscité des réactions est lorsqu’il a osé une comparaison entre l’Ukraine et Taïwan, rappelant l’importance du principe de l’intangibilité des frontières et du rejet des doubles standards.
Le Centre Asie de l’Ifri a récemment organisé un séminaire sur la mission nommée « Clemenceau 25 », un déploiement du groupe aéronaval français, avec le porte-avions Charles de Gaulle, dans l’Indopacifique. Le discours reste fermement ancré dans une volonté de présence sur place, de contribution à la liberté de navigation, à la stabilité, et au maintien d’un ordre international fondé sur des règles. Ce déploiement témoigne d’un intérêt réel pour cette région et d’une présence affirmée. Mais nous sommes également conscients du volume limité de nos forces, de la complexité du monde, et de ce que les militaires appellent parfois la « tyrannie des distances » : plus l’on s’éloigne du territoire national, plus les interventions sont compliquées.
— La question de l’Indopacifique, c’est principalement celle de la Chine. Et il me semble que la Chine se comporte de manière plutôt rationnelle, en comparaison avec les États-Unis de Trump ou la Russie de Poutine.
La Chine a une grande stratégie. Elle ambitionne d’être la première puissance mondiale en 2049, année du centième anniversaire de la République populaire de Chine. Elle accélère sa montée en puissance militaire et multiplie les démonstrations de force en mer de Chine méridionale. Les exercices et manœuvres autour de Taïwan sont fréquents. Cette pression croissante suscite une véritable inquiétude, car une guerre à Taïwan aurait des conséquences négatives et potentiellement catastrophiques dans le monde entier.
Vous mentionnez le facteur de la rationalité. Il est parfois difficile d’évaluer tous les éléments qui entrent en ligne de compte dans les calculs « rationnels » des acteurs. L’idéologie peut par exemple prendre le pas sur la rationalité économique.
Si l’on considère ces dernières années, des événements que l’on croyait improbables se sont pourtant produits, comme l’invasion de l’Ukraine à grande échelle par la Russie ou la pandémie mondiale qui a bouleversé les chaînes de valeur internationales. Il faut être très prudent lorsqu’on déclare qu’un événement est « impossible ». Les « cygnes noirs » existent, même si les probabilités d’occurrence sont faibles.
—Dans ce contexte, la relation entre le Japon et l’Europe est importante.
Absolument. Les démocraties libérales ont quelque peu perdu leur boussole face aux évolutions politiques aux États-Unis. Elles ont aussi des difficultés internes comme la montée des formations populistes ou l’instabilité gouvernementale.
Mais il reste un socle important de pays qui partagent des valeurs communes et refusent d’abdiquer face à la remise en cause de l’ordre international fondé sur des règles. Le Japon et la plupart des pays européens font partie de ces « like-minded countries » qui doivent faire front commun pour défendre la démocratie libérale et renforcer les règles de base du système international. Le développement de leur coopération est important dans le contexte actuel.

Marc Hecker est directeur exécutif de l'Ifri et rédacteur en chef de la revue
Politique étrangère. Docteur en science politique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il a enseigné à Sciences Po pendant plusieurs années. Il a écrit plusieurs livres dont La Guerre de vingt ans. Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle (Robert Laffont, 2021, avec Elie Tenenbaum ; ouvrage traduit en arabe en 2024), Intifada française ? (Ellipses, 2012) et War 2.0: Irregular Warfare in the Information Age (Praeger, 2009 avec Thomas Rid ; ouvrage traduit en mandarin en 2011). Il a publié de nombreux articles dans des revues françaises et étrangères (Commentaire, Etudes, Internationale Politik, Policy Review, etc.) et dans la presse (Le Monde, Le Figaro, Les Echos, Libération, etc.).
Politique étrangère. Docteur en science politique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il a enseigné à Sciences Po pendant plusieurs années. Il a écrit plusieurs livres dont La Guerre de vingt ans. Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle (Robert Laffont, 2021, avec Elie Tenenbaum ; ouvrage traduit en arabe en 2024), Intifada française ? (Ellipses, 2012) et War 2.0: Irregular Warfare in the Information Age (Praeger, 2009 avec Thomas Rid ; ouvrage traduit en mandarin en 2011). Il a publié de nombreux articles dans des revues françaises et étrangères (Commentaire, Etudes, Internationale Politik, Policy Review, etc.) et dans la presse (Le Monde, Le Figaro, Les Echos, Libération, etc.).
同じカテゴリの刊行物
コメンタリー
2026.02.19 (木)
コメンタリー
2026.02.18 (水)
コメンタリー
2026.01.27 (火)